Accueil > Au jour le jour > Haut Parleurs > Mónica González : en Amérique Latine les journalistes deviennent de (...)
 Mónica González : en Amérique Latine les journalistes deviennent de simples prête-noms
Mónica González : en Amérique Latine les journalistes deviennent de simples prête-noms
dimanche 16 mai 2010
Poursuivie sous la dictature de Pinochet, la journaliste chilienne Monica González continue, en démocratie, son combat pour un journalisme libre et de qualité. Elle vient d’en être récompensé par l’Unesco qui lui a décerné le Prix de la liberté de la presse UNESCO-Guillermo Cano 2010. Interview.
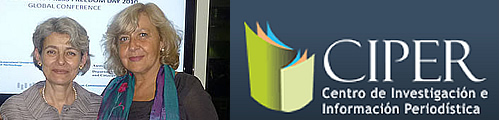
Comme d’autres journalistes chiliens, Mónica González a connu temps pas mal de déboires sous la dictature du général Pinochet. C’était un temps où dire la vérité, surtout par voie de presse, pouvait couter très cher.
Avec le retour de la démocratie, les menaces contre la liberté de presse ont changé de nature mais n’ont pas disparu pour autant. La concentration sans limites de la propriété des médias et la méfiance ou, tout au moins, le manque d’enthousiasme dont font preuve des nombreux gouvernement à l’égard de la liberté de la presse et des journalistes font que, dans ce domaine aussi, "la lutte continue".
Correspondante au Chili du quotidien argentin Clarín et directrice du Centro de Información e Investigación Periodística (CIPER) Mónica Gonzalez a reçu le 3 mai dernier, journée mondiale de la liberté de la presse, le Prix de la liberté de la presse UNESCO-Guillermo Cano 2010 [1] parce que, selon le communiqué de l’Unesco, "incarne l’esprit même de cette récompense. Elle a été emprisonnée, torturée, traînée en justice mais elle a tenu bon. Dans sa vie professionnelle, (elle) a fait preuve de courage en éclairant la partie sombre du Chili".
Journalistes : concepteurs de feuilles de route citoyennes
– Vous avez reçu le Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO-Guillermo Cano. Que signifie cette récompense pour vous ?
C’est tout simplement incroyable. C’est une émotion énorme mais aussi une immense responsabilité, celle de se montrer à la hauteur et de ne décevoir personne. J’ai le sentiment qu’un prix comme celui-ci n’est pas une incitation à s’endormir sur ses lauriers mais à continuer de travailler.

Mes premières pensées vont à mes très nombreux confrères chiliens, célèbres et anonymes, qui ont ouvert avec moi cette voie si importante et auxquels l’on n’a jamais rendu hommage. À l’époque où il n’y avait pas d’élus et où presque personne n’élevait la voix, c’est nous qui avons proposé le meilleur journalisme possible pour raconter ce qui se passait au Chili à ceux qui voulaient bien écouter et savoir. À cette époque, nous vivions dans la peur. Je leur dédie ce prix, à eux tous, ainsi qu’à leurs épouses, leurs maris, leurs amours et leurs enfants, qui ont souffert eux aussi. Je sais que chacun d’entre eux va se sentir représenté par ce prix, qui est également le leur.
– Quel regard portez-vous sur le paysage médiatique de l’Amérique latine ?
Deux problèmes menacent de plus en plus - et de plus en plus vite - le droit de la société à s’informer. Le premier, c’est l’impressionnante concentration de la propriété des médias, qui existe d’ailleurs aussi aux États-Unis et en Espagne.
Dans beaucoup de pays, on observe un modèle qui conduit à cette concentration de la propriété, elle-même inséparable d’un autre phénomène : à savoir que les groupes économiques qui mettent la main sur les médias, concentrant ainsi télévision, radio et presse écrite, ont en même temps des intérêts dans d’autres secteurs, comme l’agriculture, l’industrie minière, les services, l’immobilier, etc. Il en résulte donc un étouffement impressionnant de l’information car un média ne peut pas traiter avec objectivité des entreprises dans lesquelles son propriétaire possède des parts. C’est très grave. Les journalistes sont en train de perdre leur autonomie, leur dignité et leurs qualités ; ils deviennent de simples prête-noms.
La seconde menace émane de gouvernements autoritaires qui, bien qu’ils soient arrivés démocratiquement au pouvoir, comme c’est le cas au Venezuela, font des journalistes leurs ennemis et les soumettent à des menaces permanentes. Là encore, il n’y a malheureusement pas d’opposition capable de défendre la liberté d’information comme il se doit. Parce que la liberté d’information, ce n’est pas être partisan du gouvernement ou de l’opposition, c’est faire du journalisme de qualité. Cette menace est en train de s’étendre à d’autres pays, comme le Nicaragua, ou encore l’Équateur, où le président commence à voir les journalistes comme ses ennemis. Je pense que c’est très grave : tout comme il est inadmissible que les cartels du crime organisé partent en guerre contre les journalistes, il est inacceptable que des gouvernements démocratiquement élus fassent de même et se livrent à des pratiques autoritaires. Si on ajoute à cela la concentration de la propriété dont je parlais auparavant, le paysage médiatique est, en toute objectivité, décourageant ; il illustre une précarité du journalisme qui affecte profondément la société.
Le problème ne se limite pas à la personne dujournaliste ; c’est toute la démocratie qui est mise à mal et fragilisée car un citoyen mal informé est la proie de petits tyrans antidémocratiques. Alors nous qui avons subi des dictatures et qui n’avons recouvré la liberté qu’au prix de tant de vies perdues, nous pensons qu’on ne peut pas laisser la démocratie se fragiliser et être encore une fois utilisée par des pouvoirs autoritaires. Le pire, c’est que tout cela a lieu dans une indifférence absolue.

- Vous avez fondé il y a trois ans le Centro de Información e Investigación Periodística (CIPER). Pouvez-vous nous expliquer sa mission et son fonctionnement ?
Le centre a été créé il y a trois ans pour faire du journalisme d’enquête et d’analyse. Nous ne sommes pas une agence de presse dans le sens où, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas tant les nouvelles que leur contexte, leur origine et surtout leurs effets sur la société. Nous essayons de décrypter des faits complexes. Nous ne nous interdisons aucun sujet. La seule limite que nous nous fixons est la vie privée ; sauf si l’on découvre que des fonds publics sont utilisés pour entretenir des amants ou des maîtresses, pour abuser de mineurs, ou que des personnes qui s’érigent en gardiens de la morale et des bonnes mœurs font tout le contraire de ce qu’elles préconisent dans leur vie privée.
Nous pensons, de plus, que dans nos sociétés il y a un attrait chaque jour grandissant pour les sujets frivoles : c’est une sorte de « remède miracle », terrible et pervers, qui a pour effet d’endormir les gens et de leur donner l’impression de tout savoir, alors que tout n’est que commérage. Pendant ce temps-là, tout ce qui importe vraiment a lieu à leur insu, littéralement sous leur nez, parce que les médias n’en parlent pas.
– À votre avis, où en est aujourd’hui le journalisme d’investigation ?
C’est sans aucun doute le journalisme le plus en crise de par le monde. L’investigation a été la première victime de la crise économique, et ce sont les journalistes les plus chers qui ont été licenciés en premier, ceux-là mêmes qui font un travail d’enquête en profondeur. De plus, c’est un type de journalisme qui est souvent source de problèmes et de conflits pour les médias. La crise est par conséquent une formidable excuse pour pouvoir fermer un service qui est le mieux à même d’approfondir les vrais sujets brûlants et déterminants dans la vie des citoyens. Les médias évitent ainsi de susciter des problèmes avec les gouvernements, les mafias du crime organisé, mais surtout avec les groupes publicitaires qui les entretiennent.
Je dois quand même souligner que le journalisme d’investigation en Amérique latine n’a rien à envier à la qualité du journalisme anglo-saxon. Et pas seulement aujourd’hui, puisque nous l’avons exercé sous la dictature. Au Chili, par exemple, les crimes de celle-ci ont été dénoncés et les journalistes ont encouru pour cela des risques impressionnants. On gagnait très peu mais sous un tel régime il n’y a pas d’autre choix possible : un journaliste dénonce les irrégularités et les horreurs, ou il n’est qu’un complice. Et c’est vrai que le journalisme d’investigation implique toujours une grande part de sacrifice personnel : il suppose d’y aller de sa poche parce que, soyons objectifs, aucun média n’est disposé à payer un journaliste des mois durant pour que celui-ci puisse enquêter et faire des révélations.
En somme, je pense que le journalisme fait aujourd’hui face à un défi de taille, qui ne se limite pas à la lutte contre les atteintes à la vie, comme au Mexique, où cinq journalistes sont déjà morts cette année, au Honduras, où l’on dénombre pas moins de six décès, ou encore en Colombie, où le crime organisé et les mafias paramilitaires, ce qui revient au même, menacent les journalistes en permanence. Le problème, c’est que ces cartels de narcotrafiquants sont en train de ronger notre société. Leur objectif final, c’est de nous priver d’espaces de plaisir, de bonheur et de vie. C’est pour cela qu’il est si important de s’y attaquer, et c’est aussi pour cela qu’il est si important de garantir aux journalistes la possibilité d’enquêter et d’informer, contrairement à la pratique actuelle dans la plupart des pays d’Amérique latine.
– Quel accomplissement a été important dans votre vie professionnelle ?
Le plus important pour moi, c’est d’avoir su passer de la dictature à la démocratie sans renoncer au journalisme. Pendant la dictature, je n’ai renoncé ni en prison, ni sous la torture, ni quand mes amis ont été tués, ni quand j’ai dû me séparer de mes filles, ni quand j’ai partagé la douleur de tant de personnes dans ce pays. Lorsque la démocratie est arrivée, j’ai senti qu’il y avait tant à construire. Mon mérite, c’est de ne pas avoir abandonné le journalisme et de m’être réinventée chaque fois je me suis retrouvée au chômage. J’y suis parvenue grâce à l’aide de beaucoup de gens ; je ne suis pas Superwoman. Je suis reconnaissante d’avoir rencontré des personnes qui m’ont soutenue et m’ont encouragée à persévérer lorsque j’avais le plus peur. De plus, dans ce métier, on est mis à l’épreuve tous les jours et j’entends que cela reste de même jusqu’à ma mort.
– Pensez-vous que ce prix puisse contribuer, d’une façon ou d’une autre, à mettre en valeur des confrères qui traversent des situations difficiles dans d’autres pays d’Amérique latine ?
Aujourd’hui, les vrais héros sont en Colombie, au Mexique, au Honduras, au Guatemala, au Venezuela... et au Chili. Pour moi, le journalisme le plus héroïque, c’est celui qui informe tous les jours, qui ne connaît ni horaires fixes, ni week-ends, parce que son but, c’est que le citoyen puisse continuer à aller de l’avant. Nous sommes les concepteurs de feuilles de route citoyennes qui, parfois, sont tracées dans le sang, la douleur et la peur.
J’aimerais vraiment que ce prix contribue à faire comprendre au citoyen ordinaire que les journalistes sont des êtres humains et que nous avons besoin de travailler dans le respect et dans la dignité.
Propos recueillis par Carolina Jerez et Lucía Iglesias (UNESCO)
[1] Organisé avec le soutien de la Fondation Guillermo Cano, la Nicholas B. Ottaway Foundation et JP/Politiken Newspapers LTD, le Prix mondial de la liberté de la presse est destiné à distinguer une personne, une organisation ou une institution qui a contribué d’une manière notable à la défense et/ou à la promotion de la liberté de la presse où que ce soit dans le monde, surtout si pour cela elle a pris des risques.
 La Francolatina
La Francolatina